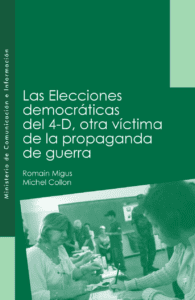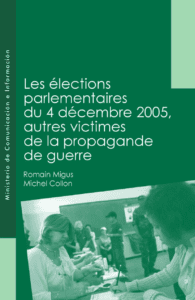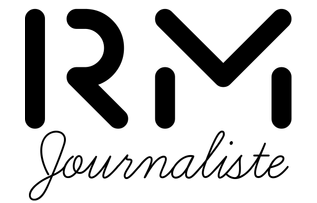Carlos Ball est un entrepreneur et journaliste vénézuélien. Apres avoir fondé sa propre entreprise de loueur de voiture, Carlos Ball fut un membre fondateur et associé du Journal La Verdad, pour selon ses propres mots « combattre l’influence écrasante de l’extrême gauche dans la presse vénézuélienne de l’époque, où des journaux comme El Nacional faisait ouvertement le jeu de la guérilla castriste et où El Universal était dans une de ses fréquentes période de timidité » (El Nacional et El Universal sont aujourd’hui les deux principaux quotidiens antichavistes militants).
Il entre comme directeur du journal El Diario de Caracas en 1984. Ce journal est une des propriétés du groupe médiatique 1BC que dirige Marcel Granier et qui possède entre autres media, la chaîne de télévision RCTV. En 1991, il fonde aux Etats-Unis sa propre agence de presse, spécialisée dans les sujets économiques, l’Agence Interaméricaine de Presse Economique (AIPE).
Il est membre de la Fondation Héritage, think tank étasunien ultra-conservateur. Carlos Ball est aussi un des fondateurs du Centre pour la Divulgation de la Connaissance Economique (CEDICE), qui fut créé à Caracas en 1984 avec l’argent du Centre International pour l’Entreprise Privée (CIPE), une des branches du Fonds National pour la Démocratie (NED). Le CEDICE est un centre d’investigation ultralibéral dont les réflexions alimentent le discours économique de l’opposition. Sa directrice, Rocío Guijarro, a signé le Décret Carmona, qui autoproclamait la dictature, lors du coup d’Etat d’avril 2002.
Admirateur de Friedrich von Hayek et membre de la Société du Mont Pèlerin fondée par ce dernier, Carlos Ball fait partie du CATO institute, autre think tank ultralibéral basé aux Etats-Unis, dont les travaux sur la privatisation du système de retraite ont inspiré George W. Bush. Il ne s’agit donc pas d’un révolutionnaire bolivarien, mais d’un penseur de droite, écoeuré par les us et coutumes de la IVe République vénézuélienne.
Le témoignage de Carlos Ball est éclairant sur les rapports entre le groupe 1BC que dirige Marcel Granier avec les pouvoirs politiques corrompus de la IVe République. Il relate son expérience en tant que directeur du journal El Diario de Caracas. Chacun jugera du degré de liberté d’expression qui existait au Venezuela avant le gouvernement bolivarien.
Le témoignage :
Les obstacles au journalisme
« (…) Le véritable obstacle a fait son apparition quand Lusinchi [président du Venezuela de 1984 à 1989, issu du parti social-démocrate Accion Democratica-ndt] a ordonné l’emprisonnement du [journaliste-ndt] Rodolfo Schmidt, pour des écrits qui avait beaucoup dérangé à Miraflores [le palais présidentiel-ndt] parce que ce qui était écrit était vrai. Les mensonges, eux, n’affectent personne. Alors que Rodolfo était en prison depuis déjà deux mois, on m’a adressé un message très clair: sa liberté contre l’arrêt des publications dans le Diario de Caracas des articles de José Vicente Rangel [ancien vice-président de la République Bolivarienne du Venezuela, journaliste à l’époque-ndt] et Alfredo Tarre Murzi (Sanín) [journaliste vénézuélien et ancien sénateur démocrate-chrétien-ndt].
La deuxième condition a été la suspension des investigations en cours au journal de quatre cas de corruption au sein du gouvernement et de la police.
Ma première réaction a été de vouloir tout laisser tomber et retourner à mon commerce de location de véhicules, qui avait bien marché pendant douze ans parce que je n’avais jamais rien loué au gouvernement. Mais mon départ aurait signifié une double victoire pour Miraflores. Un vendredi après-midi, je me suis réuni dans mon bureau avec Rangel et Sanin pour leur dire exactement ce qui se passait, et leur annoncer que notre première priorité était Rodolfo, et que donc ils étaient suspendus. Le mardi suivant, Schmidt était remis en liberté.
Le gouvernement de Lusinchi voulait que la presse devienne le porte parole du gouvernement et répète comme un perroquet l’information « véridique » de l’OCI [Officine Central d’Information, ancienne direction de Communication du Palais Présidentiel-ndt]. Il s’en assurait en subventionnant par-dessous la table des journalistes clés, ces subventions étaient bien au dessus des salaires perçus par ces journalistes. Et la publicité qui provenait de l’Etat dépendait en grande partie de la cécité face aux abus et à la corruption des puissants.
Pour moi, le plus difficile dans mon travail, c’était lorsque je devais aller de temps en temps à Miraflores. Je me rappelles que, en tant que trésorier du Bloque de Prensa [Bloc de Presse, corporation vénézuélienne de la presse composée de patrons et directeurs de presse ainsi que de « journalistes » servant les intérêts des premiers, le Bloque de Prensa a condamné comme atteinte à la liberté d’expression le choix souverain du gouvernement de ne pas rénover la concession de RCTV-ndt], j’ai dû assister à une réunion avec Lusinchi et son cabinet économique pour discuter de la difficulté d’obtenir des dollars pour importer du papier. Avec le contrôle des changes, on obtenait des dollars seulement en payant des commissions aux fonctionnaires. Après avoir expliqué au Président que sans dollars, il n’y a pas de papier, et que sans papier, il n’y a pas de journaux, le Président Lusinchi, avec le ton du suprême bienfaiteur donnât aux ministres présents des instructions pour éliminer toutes les trames bureaucratiques pour obtenir des dollars pour les membres du Bloque de Prensa. Mes collègues avaient le sourire jusqu’aux oreilles pendant que moi, je songeais aux milliers de commerçants qui n’avaient pas accès au Palais, et que nous, les membres de ce qu’on appelle le quatrième pouvoir, étions censés défendre.
Mais ce qui suivit fut encore pire. Lusinchi a passé plus de deux heures à déblatérer contre le Diario de Caracas, où selon lui, son gouvernement était attaqué jusque dans les pages sportives. En trois ou quatre occasions, je lui ai dit qu’il se trompait et j’ai vu dans ses yeux la surprise liée à ce que quelqu’un ait osé lui répondre.
Mais plus grande fut ma surprise le jour suivant, lorsque j’ai informé en détail de ce qui s’était passé les propriétaires du journal, et que l’un d’eux m’a dit : « Carlos, tu dois apprendre qu’on ne conteste pas le Président. »
Quand nous avons publié en première page les manœuvres initiales de Carmelo Lauria [ancien directeur de cabinet des Présidents Jaime Lusinchi et Carlos Andres Perez, ancien député d’Accion Democratica et ancien membre du Comité de l’Internationale Socialiste pour l’Amérique latine et la Caraïbe-ndt] et Alvarez Stelling [ancien président de la Banque Consolidado, ruinée par la crise bancaire de 1994-ndt] pour mettre la main sur la Banque du Venezuela, le directeur de cabinet du Président [Carmelo Lauria-ndt] me fit dire qu’il n’avait pas peur du directeur du Diario de Caracas, j’ai répondu le 12 octobre 1986 dans un article intitulé « Carmelo, moi j’ai peur de toi ».
Les agents des impôts sur la rente venaient me visiter fréquemment à l’appartement du quartier Avila, où je résidais. Sur le compteur de la CANTV [entreprise de télécommunications encore publique sous le gouvernement de Lusinchi, privatisée ensuite et aujourd’hui renationalisée par le gouvernement bolivarien-ndt], en face de chez moi, il était inscrit au marqueur le nom « Bol ».
Au fur et à mesure que la diffusion du Diario de Caracas augmentait, la publicité baissait. D’abord, on a perdu toute la publicité qui venait du gouvernement et des entreprises d’Etat, ensuite celle des grandes entreprises qui faisaient des affaires avec le gouvernement.
Pour moi, le commencement de la fin a eut lieu en mars 1987, alors que je devais présenter à la Société Interaméricaine de Presse, réunie à San Antonio, Texas, le rapport du Venezuela à la Commission de Liberté de la Presse. Là, j’ai énuméré les abus du régime de Lusinchi et l’intention du gouvernement d’installer une fabrique de papier pour la presse afin de suivre l’exemple du PRI [Parti de la Révolution Institutionnelle-ndt] mexicain et contrôler la presse au moyen de l’administration du papier.
Je n’ai aucun doute que c’était là l’unique but de ce projet de fabrique de papier, qui allait coûter 400 millions de dollars, et créer à peine mille emplois. $400.000 par poste de travail alors que l’industrie privée créait un nouvel emploi en investissant à peine $10.000, et dans le secteur informel $500.
Quand je suis revenu à Caracas, j’ai été informé que ce qui s’était passé avait été rapporté a Hernán Pérez Belisario, vice-président du groupe Radio Caracas Télévision [RCTV-ndt]. Le problème qui se posait à moi fut que Hernan était un ami intime de Blanca Ibáñez [secrétaire et maîtresse du Président Lusinchi. Elle était considérée comme la personne du pouvoir occulte, et fut responsable de multiples cas de corruption. Elle vit aujourd’hui aux Etats-Unis en toute liberté et mariée à Jaime Lusinchi-ndt], laquelle avait notamment –selon l’information rassemblée- une participation dans l’actionnariat de l’entreprise de Perez Belisario, celle qui fabriquait tous les téléphones de la CANTV.
Mon nouveau chef m’a d’abord dit qu’il ne voyait pas la nécessité de publier des éditoriaux quotidiens dans le Diario de Caracas. Après tout, El Universal ne le faisait pas. Mais comme je n’ai pas éliminé l’éditorial, il m’a ordonné de le lui lire par téléphone chaque soir avant la publication, pour s’assurer ainsi qu’il n’y ait aucune critique contre le gouvernement.
Cela signifiait que bien souvent il fallait réécrire l’éditorial à la dernière minute, alors que ce que j’avais envie de faire c’était de laisser l’espace en blanc comme le faisait fréquemment La Prensa du Nicaragua à cause de la censure du gouvernement sandiniste. L’autocensure est encore plus indigne.
Peu après, Perez Belisario m’a informé qu’il était en train d’organiser un petit déjeuner au Diario de Caracas en l’honneur de Lusinchi et Blanca. Immédiatement, j’en ai informé Marcel Granier, qui à l’origine m’avait amené au Diario, et je lui ai dit que je respectais trop le journal comme institution, pour recevoir, en ma qualité de directeur général, une dame dont tout le monde savait qu’elle contrôlait les affaires sales du régime.
Le mercredi 13 mai 1987 à 16h30, Hernán Pérez Belisario est entré dans mon bureau pour me dire que j’étais viré et que je devais faire mes bagages car le président Lusinchi venait le vendredi pour déjeuner au journal.
Le problème c’était que la rénovation de la licence de transmission de Radio Caracas Télévision, propriétaire du journal était en jeu, et qu’apparemment ma tête en était le prix à payer. [C’est cette même concession de 20 ans, attribuée comme on le voit en mai 1987 qui est en passe de se terminer. Par la bouche de l’ultralibéral Carlos Ball, on peut donc confirmer qu’il ne s’agit en rien de la fermeture arbitraire de RCTV par le gouvernement bolivarien-ndt]
Ce vendredi, alors que Lusinchi, tout sourire, écrivait à la machine dans la rédaction du journal une phrase célèbre qui fut publiée en première page le jour suivant, « C’est un pêcher de parler du gouvernement en mal », j’étais au 5e Tribunal d’Instruction, où le juge Ramírez Colmenares m’a dit : « Dr. Ball, je ne vois pas grand-chose dans votre cas, mais vous comprenez, j’ai des instructions d’en haut ».
J’étais accusé d’avoir accaparé des véhicules, dans l’objectif supposé de bénéficier d’une hausse des prix régulés, alors que j’avais arrêté de diriger l’entreprise [de location de véhicules-ndt] en décembre 1983. Cette nuit là, quand je suis rentré chez moi, Anita, ma femme, m’a dit: « on s’en va, maintenant que tu n’as plus le journal pour te protéger, tu vas finir en prison. » Nous avons émigré aux Etats-Unis et, peu après, les charges contre moi furent retirées.
Je me dois d’ajouter qu’en 1987 [après la sortie de Carlos Ball-ndt], El Diario de Caracas a gagné le Prix National de Journalisme. »
Carlos Ball.
Extrait de l’interview de Carlos Ball, « La excelencia en el periodismo » publiée en 1999 sur le site Venezuela Analítica : http://www.analitica.com/art/1999.06/excelente/00007.asp.
Traduction : Romain Migus, Mathilde Gauvain